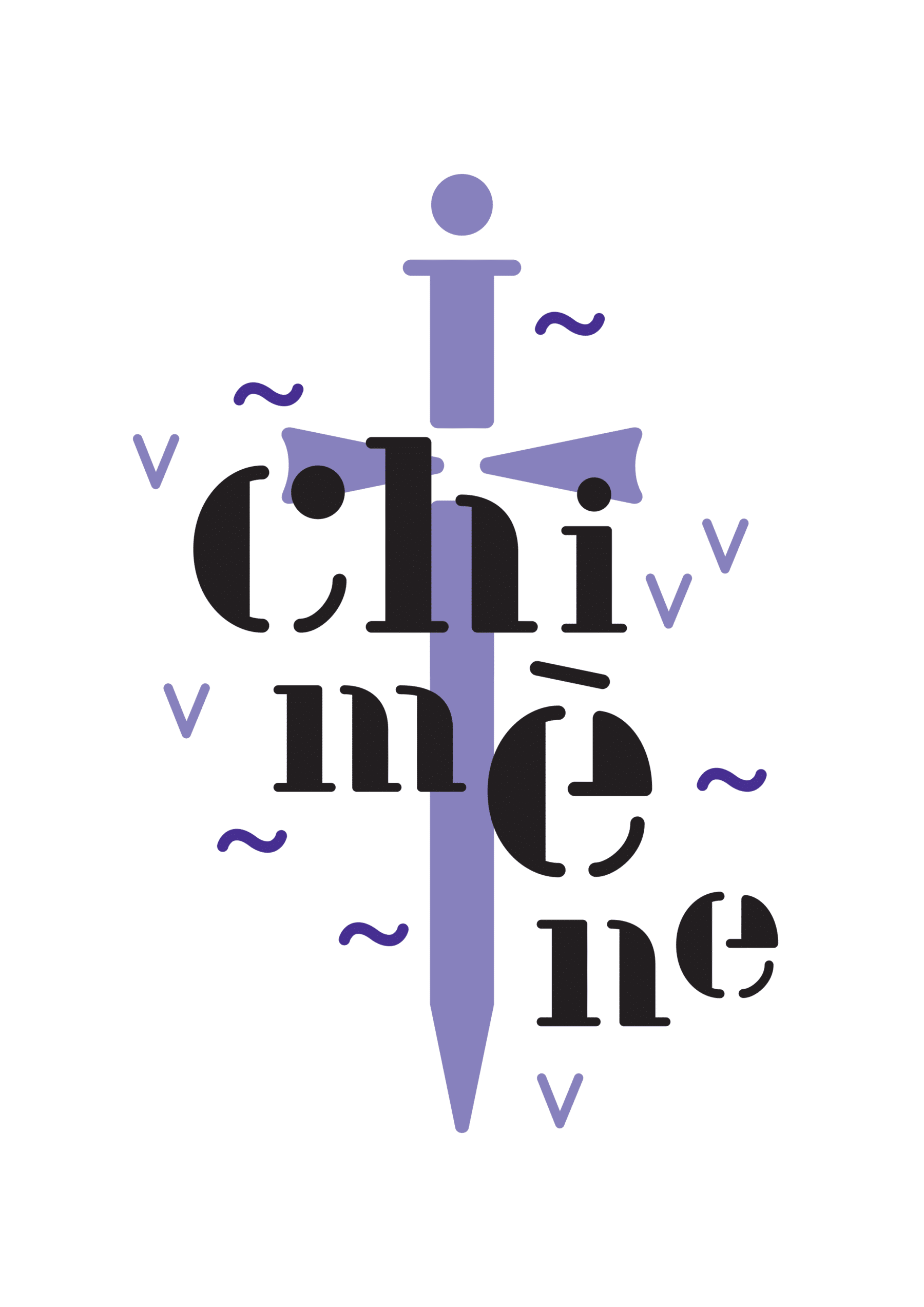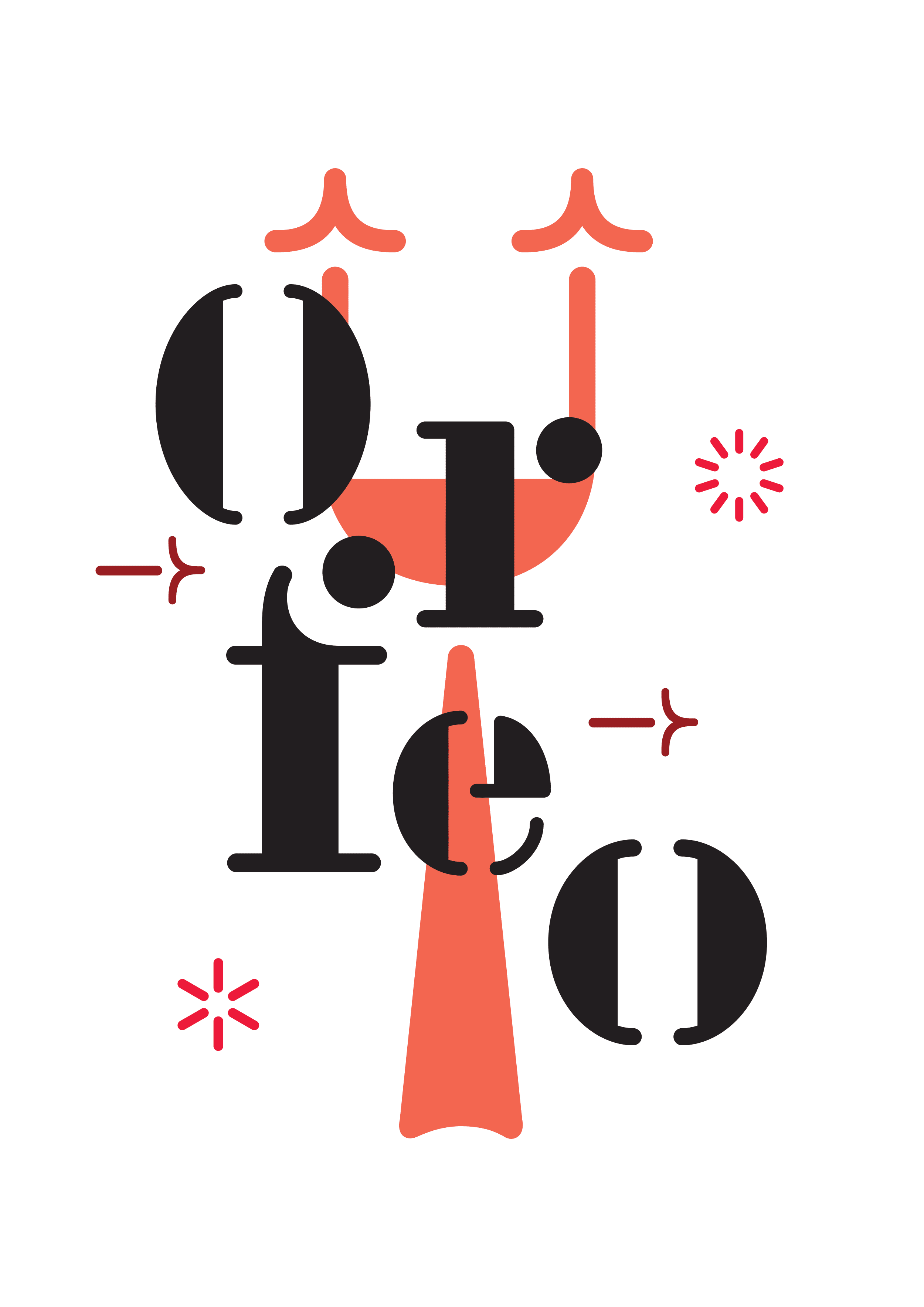
Ce spectacle est disponible en tournée.
Votre contact : Catherine Lafont – +33 (0)6 67 33 26 59
Orfeo
Opéra (Venise, 1672)
Musique Antonio Sartorio
Livret Aurelio Aureli
Un Orphée inédit redécouvert par le duo Jaroussky | Lazar
Mise en scène Benjamin Lazar
Direction musicale Philippe Jaroussky
Ensemble Artaserse
Ne te retourne pas
Une redécouverte par le duo Jaroussky/Lazar
Célébrons ici l’esprit de transmission qui anime Philippe Jaroussky et permet de retrouver le fil de ses premiers rôles il y a 20 ans.
Téléchargez la Fiche DiffusionFichier PDF – 8 Mo
Argument
Les noces festives d’Orphée et d’Eurydice laissent rapidement place à l’enfer : lorsque son frère Aristée presse Eurydice de répondre à son amour, Orphée ne le réprimande pas mais, fou de jalousie, conçoit pour sa femme une haine mortelle. Dans une cour aux multiples intrigues, où les serviteurs Erinda et Orillo jouent en eaux troubles, où les apprentis philosophes oublient leurs préceptes à la première beauté, et où les figures fantastiques des centaures, animaux et dieux ajoutent à l’ambigüité des apparences, Eurydice et Autonoe, la fiancée d’Aristée, lutteront solidairement pour leur vie et leur amour. Poursuivie par Aristée, Eurydice se fait mordre par un serpent. Orphée, pressé par l’ombre d’Eurydice de venir la chercher aux enfers, amadoue Pluton mais malgré l’injonction de ne pas la regarder avant la sortie, se retourne et la perd. Seule la réconciliation finale du couple Aristée-Autonoe fait naître un espoir dans les facettes sombres de l’amour qu’explore cet opéra.
Présentation par Catherine Kollen
Un opéra de la grâce et de la cruauté
Cette redécouverte en première française que nous offrent Benjamin Lazar et Philippe Jaroussky d’un nouvel Orphée est un événement à plus d’un titre :
Révélant au public un opéra vénitien de la fin du 17e siècle, où le chant expressif met en relief le texte, avec une musique riche et colorée, cet Orphée original explore la face noire des sentiments amoureux, où la jalousie se nourrit du narcissisme, Orphée allant même jusqu’à commanditer le meurtre d’Eurydice.
30 ans après le Couronnement de Poppée de Monteverdi, la liberté de ton propre à la République de Venise fait toujours merveille dans les livrets, mêlant sérieux et dérision, lumière et ombres dans les personnages, dans des situations d’une grande modernité, avec deux femmes admirablement fortes et solidaires qui vont lutter pour leur amour et leur vie. Comme un palais des miroirs, où le fond des âmes va s’exposer au fur et à mesure, la scénographie d’Adeline Caron, magnifiée par les lumières de Philippe Gladieux et les costumes chatoyants d’Alain Blanchot, passe du conte de fées à un conte cruel, qui se termine malgré tout sur une note d’espoir.
Nouveaux chemins et retour aux sources
Après ses débuts de chef d’orchestre fortement applaudi lors d’un Jules César de Haendel en 2022, Philippe Jaroussky continue cette aventure dans la fosse avec son ensemble Artaserse, qu’il dirigera pour les représentations de septembre-octobre 2023 avant de passer la baguette à Brice Sailly, claveciniste de talent qui a collaboré avec l’Arcal au Couronnement de Poppée en 2010-11.
Après la création à l’Opéra national de Montpellier-Occitanie en juin 2023, Philippe Jaroussky et Benjamin Lazar prépareront une troupe talentueuse de jeunes chanteurs dans les lieux où ils ont fait leurs premières armes ; la Fondation Royaumont pour les deux et l’Arcal pour Philippe Jaroussky, avant de partir en tournée en 2023-24.
Célébrons ici l’esprit de transmission qui anime Philippe Jaroussky et permet de retrouver le fil de ses premiers rôles il y a 20 ans.
L’œuvre par Jean-François Lattarico
Antonio Sartorio a surtout composé des opéras et de la musique vocale. Il exerça son activité principalement dans sa ville natale de Venise et à Hambourg. On connaît peu de choses sur sa vie et sa formation, néanmoins, de 1666 à 1675, il fut maître de chapelle du duc Jean-Frédéric de Brunswick-Lunebourg (actuel Land de Basse-Saxe). Démis de cette charge, il revint à Venise où il occupa le poste de vice-maître de Chapelle de Saint-Marc, de 1676 à sa mort.
Les œuvres d’Antonio Sartorio présentent des caractères typiquement vénitiens de la seconde moitié du XVIIe siècle : plus précisément ses livrets appartiennent à la catégorie du « drame héroïque » plein d’intrigues, de déguisements, d’astuces, de sorts, et témoignent du triomphe de l’inventio au détriment de l’historia et de la transformation du recitar cantando des Florentins en cantar recitando chez les Vénitiens.
La tonalité cantabile est donnée dès la scène liminaire avec le duo des deux amants (Cara e amabile catena), mais dans cet opéra tardif, le passage du declamando vers l’arioso, puis l’aria, se fait sans heurts. Sartorio a retenu la leçon de Cavalli (1602 – 1676) ; le pathos devient langueur, notamment dans l’aria È morta Euridice, et plus encore dans la scène suivante où l’air magnifique Se desti pietà est précédé d’un récitatif d’une grande force expressive.
Distribution
Direction musicale Philippe Jaroussky du 27 sept. au 16 déc. 2023 | Brice Sailly le 2 mars 2024
Ensemble Artaserse
Mise en scène Benjamin Lazar
Scénographie Adeline Caron
Lumières Philippe Gladieux
Costumes Alain Blanchot
Maquillages et perruques Mathilde Benmoussa
Collaboration artistique Elizabeth Calleo
Directeur des études musicales Brice Sailly
Cheffe de chant Yoko Nakamura
Diction italienne Barbara Nestola
Traduction livret Jean-François Lattarico
Partition-édition moderne Yannis François
Stagiaire à la mise en scène Pierre Florac
Avec les chanteur·euse·s
Lorrie Garcia Orphée
Michèle Bréant Eurydice
Eléonore Gagey Aristée
Anara Khassenova Autonoe
Alexandre Baldo Esculape | Pluton
Matthieu Heim Chiron | Bacchus
Abel Zamora Hercule
Fernando Escalona Achille
Clément Debieuvre Erinda
Guillaume Ribler Orillo
Et les danseu·r·seuse·s
Gabriel Avila Quintana Sanglier
Théo Pendle Cerf
Chloé Scalese Félin
Equipe technique Arcal
Stéphane Holvêque direction technique
Ugo Coppin régie générale | Lumières
Rémi Remongin régie plateau
Luigi Legendre régie orchestre & surtitrage
Mathilde Benmoussa, Elisa Provin, Augustin Chemelle & Pauline Sillard maquillage & habillage
Nevena Aritonovic stagiaire de 3e maquillage | coiffage | habillage
Production
Nouvelle coproduction en première française Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical (Dir. Catherine Kollen) • Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie • Fondation Royaumont • Théâtre-Sénart, scène nationale.
Coproduction de la reprise (2024-25) Atelier Lyrique de Tourcoing
Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet.
Soutien au projet
Le CNM (Centre national de la Musique)
La SPEDIDAM – La Spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
Note d’intention de Benjamin Lazar • Le miroir vénitien
de la folie d’Orphée
L’amour comme un noir choléra
L’Orfeo d’Antonio Sartorio offre une image très différente de la légende d’Orphée que celui de Claudio Monteverdi. Les scènes y sont courtes, les nombreux personnages s’y succèdent à vive allure, alternant les atmosphères sensuelles, pathétiques, comiques et tragiques. Au sein de ce ballet chatoyant des corps et des cœurs portés par la beauté de la musique, l’amour circule comme une énergie noire.
Le mythe est en effet réécrit avec l’acuité clinique de l’époque moderne. La passion amoureuse y cause plus de douleurs que de joies : la jalousie, la misogynie et les frustrations y font exister l’Enfer avant la mort. À rebours de son image habituelle, Orphée est un être possessif et méfiant, doutant de l’amour de son épouse. Aristeo, le frère d’Orphée, personnage emprunté a une version du mythe raconté par Virgile, aime également Eurydice, et la violence de sa passion va provoquer le drame : poursuivie, Eurydice est piquée par le serpent fatal. Esculape, médecin et troisième frère d’Orphée, regarde avec cynisme ces ravages de l’amour.
La force d’Eurydice
Loin de la nymphe fragile qui n’a pour fonction que de mourir et d’être pleurée, Eurydice est l’une des grandes réussites du livret d’Aurelio Aureli. Elle y déploie une grande puissance de caractère, luttant pour garder son amour et sa vie. C’est elle-même qui, dans une scène-clef extraordinaire, revient en fantôme demander à Orphée de venir la chercher aux Enfers. C’est elle encore qui demande à Orphée de ne pas se retourner.
Autour de ce trio amoureux, la princesse Autonoé, promise à Aristeo, joue la partition de la femme trahie venue reconquérir son amour en se faisant passer pour une autre. Son alliance avec Eurydice qui les rend solidaires dans l’adversité plutôt que rivales, est un autre trait moderne du traitement de cette histoire.
Pour les parties comiques, les jeunes héros Hercule et Achille sont surpris comme des adolescents par les sentiments d’attendrissement et de fureur que provoque en eux le sentiment amoureux. Orillo, jeune berger voyou, a des airs d’une grande douceur mais n’hésite ni à vendre ses charmes à la vieille et riche entremetteuse Erinda ni à accepter la mission du meurtre d’Eurydice commandité par Orphée lui-même, rendu fou par la jalousie qui exacerbe son narcissisme.
À cette vérité crue des passions amoureuses révélant tour a tour l’aspect comique, héroique ou noir des personnages se mêle un onirisme mythologique : Pluton, Bacchus et le centaure Chiron ont leur place au milieu des mortels. Ce sont les incarnations chantantes des forces intérieures de vie et de mort , de raison et de folie qui agitent les personnages.
Un cruel et gracieux palais des mirages
Il faut répondre à cette énergie colorée et noire par une mise en scène changeante, offrant une diversité dans les images, les costumes et les styles de jeu. Retrouver Philippe Jaroussky quinze ans après notre collaboration dans Il sant’Alessio où il interprétait le rôle-titre est pour moi une occasion de synthèse entre l’approche baroque et les traitements plus visiblement contemporains que j’ai pu explorer sur de nombreuses œuvres du seicento et d’autres répertoires.
Avec mon équipe, j’imagine cette version d’Orphée dans un palais des mirages, conçu par Adeline Caron, qui tient a la fois du planétarium, du théâtre anatomique de la Renaissance et du cabaret contemporain. Les êtres s’y entreregardent avec amour ou s’y épient avec acidité. Erinda, l’entremetteuse, y règne en maitresse, comme une tenancière manipulatrice. Les miroirs cachés apparaissent comme un piège où se retrouve enfermée Eurydice, et où Orphée se regarde complaisamment. La forêt de la mort s’y dessine aux travers des claire-voies qui fragmente les lumières de Philippe Gladieux. Le ciel étoilé suspendu inspiré des verres de Murano, éphémères lueurs du bonheur du mariage initial, devient la cohorte des âmes errantes des Enfers quand Orphée y descend. La remontée prend les allures d’une spirale sans fin ou la scène circulaire centrale tourne tandis qu’Orphée et Eurydice marchent sans pouvoir avancer.
Une fête vénitienne qui s’effeuille jusqu’à l’os
Les costumes d’Alain Blanchot donnent d’entrée les signes d’une fête vénitienne baroque et colorée, pour évoluer au fur et a mesure qu’Eurydice réalise qu’elle est loin d’être arrivée dans le monde idyllique du beau roi chanteur qu’elle pensait avoir épousé. Les personnages se dépouillent par couches successives et, comme l’histoire, ils finissent par laisser voir à l’os la crudité contemporaine des sentiments amoureux destructeurs.
Certaines figures restent dans un entre-monde : le centaure Chiron a une queue et une crinière de cheval, mais ses deux pattes de devant sont constituées par les béquilles du vétéran de guerre qu’il est, tentant de remettre dans le chemin de l’éducation militaire les indisciplinés Hercule et Achille. Ceux-ci, couverts de poussière a force de s’y rouler, ont un visage et un corps semblables a celui des statues qu’ils deviendront un jour.
Les animaux, que le livret faits apparaître lorsqu’Orphée chante son amour perdu seront bien présents : dans l’ombre ménagée par Philippe Gladieux, Alain Blanchot imagine des silhouettes, a mi-chemin entre le vagabond et la créature merveilleuse.
Fin tragique et fin heureuse
Tous ces êtres se croisent et se désirent depuis leurs folies et leurs mondes qui peinent à se rejoindre, mondes dont les frontières mentales prennent la forme d’un miroir par lequel on épie, d’une zone d’ombre d’ou l’on regarde un autre chanter dans la lumière.
Parfois stylisé et s’inspirant de la gestuelle baroque et de la danse, parfois naturaliste, le jeu est libre, très corporel, et rend compte de la subtilité du parcours des passions et des pensées des personnages.
Nous souhaitons inviter le spectateur dans le palais de la folie d’Orphée et de la constellation des personnages qu’il y entraîne. Entre temps passé et temps contemporain, entre veille et rêve, entre vie et mort, Orphée et Eurydice ne cessent de se chercher et de se perdre éternellement. Le duo de l’amour retrouvé entre le frère d’Orphée et sa femme finit toutefois par donner, sur le fil, une lueur d’espoir a cet opéra ou la grâce et la cruauté dansent l’une contre l’autre.
Parfois stylisé et s’inspirant de la gestuelle baroque et de la danse, parfois naturaliste, le jeu est libre, très corporel, et rend compte de la subtilité du parcours des passions et des pensées des personnages.
Nous souhaitons inviter le spectateur dans le palais de la folie d’Orphée et de la constellation des personnages qu’il y entraîne. Entre temps passé et temps contemporain, entre veille et rêve, entre vie et mort, Orphée et Eurydice ne cessent de se chercher et de se perdre éternellement. Le duo de l’amour retrouvé entre le frère d’Orphée et sa femme finit toutefois par donner, sur le fil, une lueur d’espoir a cet opéra ou la grâce et la cruauté dansent l’une contre l’autre.
Musique et théâtralité • par Philippe Jaroussky
L’Orfeo de Sartorio, créé en 1672 à Venise, est l’une des œuvres que je rêvais de diriger depuis longtemps. J’ai enregistré d’ailleurs il y a quelques années des extraits en compagnie de Emöke Barath et Diego Fasolis dans l’album La storia di Orfeo.
Il fait partie de cette époque si intéressante et inventive, encore peu jouée, à cheval sur le « recitar cantando » du premier baroque de Monteverdi et Cavalli, et le début de l’opéra qu’on qualifiera plus tard de « seria », avec son alternance d’airs et de récitatifs. L’œuvre connut un immense succès à sa création à en juger le nombre de reprises jusqu’au début du 18e siècle. Sartorio y développe en effet une très grande inventivité mélodique, alternant entre des passages très rythmiques et d’autres extrêmement poignants ou magiques, comme la mort d’Eurydice ou la scène de son ombre s’adressant à Orfeo endormi.
Les caractères des personnages et leurs interactions sont d’une très grande richesse, et il faut absolument créer une vraie troupe de chanteurs-acteurs pour pouvoir rendre pleinement justice à cette œuvre si riche !
La presse en parle
Classica • Tempo d’enfer
Enthousiasmante découverte que cet Orfeo d’Antonio Sartorio !
Philippe Jaroussky et son Ensemble Artaserse ont eu un coup de foudre pour cette œuvre qui enchaîne à un tempo d’enfer le rire et la mélancolie. […] Sur scène, Benjamin Lazar et les somptueux costumes de son complice Alain Blanchot intègrent les fastes du maniérisme dans un jeu théâtral où prime l’élégance. Vincent Borel
La Terrasse • Une recréation pleine de jeunesse
Mis en scène par Benjamin Lazar, et porté par l’Arcal pour la saison de ses 40 ans, l’Orfeo de Sartorio fait redécouvrir un jubilatoire mélange des registres typiques de l’opéra vénitien du XVIIe siècle. Un spectacle défendu par une savoureuse troupe de jeunes solistes emmenée par Philippe Jaroussky et l’ensemble Artaserse. Gilles Charlassier
[en savoir +]
Le Figaro • L’Orfeo
On sait gré à l’Arcal, compagnie lyrique qui fête ses 40 ans, d’avoir choisi cet ouvrage par trop oublié, et pour présider à cette résurrection, le contre-ténor Philippe Jaroussyk pour chef, et le metteur en scène Benjamin Lazar. Ce dernier signe une transposition moderne à l’ambiance très léchée, qui évoque aussi bien le théâtre anatomique de la Renaissance, que l’univers circassien. Le tout porté par une jeune distribution excellente en tous points. Thierry Hillériteau
[en savoir +]
Télérama • L’ «Orfeo» brille de nouveaux feux
Si Orphée n’écoute rien, les spectateurs, eux, sont tout ouïe. La musique de Sartorio, changeante et colorée, émaillée d’airs somptueux, émerveille autant qu’elle émeut.
Grâce aux talents réunis autour de sa résurrection, [Orphée] aura fait d’un mythe trois coups : enrichir le répertoire, révéler de nouveaux talents, et – pourquoi pas ? – fabriquer de nouveaux lyricomanes. Sophie Bourdais
Concertclassic • Effeuillage sentimental
La nouvelle équipe semble s’être coulée sans peine dans cette production […]
Ainsi, qui croirait que le personnage d’Erinda, vamp nymphomane sur le retour, n’a pas été élaboré sur mesure pour Clément Debieuvre, qui y remporte un légitime succès ? Qui croirait que cet Orphée ombrageux n’a pas été taillé pour Lorrie Garcia, superbe timbre de mezzo-soprano à la densité envoûtante ? Qui croirait que cet Esculape ironique et désinvolte n’a pas été imaginé expressément pour Alexandre Baldo, à l’aisance scénique et vocale souveraine Frédéric Norac
[en savoir +]
Action artistique et culturelle
L’œuvre de Sartorio est traversée par une succession de personnages qui trahissent des sentiments humains très forts : l’amour, la jalousie, la frustration, la haine… que Benjamin Lazar s’emploie à révéler dans sa mise en scène.
Autour de la musique
- Expressivité des sentiments : airs marquants de la partition, explications sur l’imbrication musique-texte (fin du XVIIe)
- Les différentes versions d’Orfeo dans l’histoire de la musique selon les périodes
- Atelier « langage voix et musique » avec un-e chanteu-r-se lyrique : le parcours d’un et/ou des personnages (extraits chantés de l’œuvre) • les différents types de voix à l’opéra
- Masterclass « clavecin » : Travail sur des extraits de l’Orfeo, œuvre qui connut un immense succès à sa création à en juger le nombre de reprises jusqu’au début du 18e siècle : inventivité mélodique, passages très rythmiques et d’autres poignants ou magiques • Intervenants : Brice Sailly, Adèle Gornet
- Masterclass chant : Travail sur des extraits de Orfeo, opéra qui à cet époque, marque le passage du «recitar cantando» du premier baroque de Monteverdi et Cavalli, et le début de l’opéra « seria » alternant airs et récitatifs. » • intervenants : chanteu-r-se-s
Autour de la dramaturgie : costumes, scénographie, lumières
- Les costumes conçus par Alain Blanchot : des costumes baroques, fastueux jusqu’au dépouillement, qui révèle des personnages comme de simples humains, avec leurs sentiments pas tous vertueux
- Présentation du métier de costumier et invitation à faire travailler les élèves sur du concret (manipulation de tissus et de matières)
- Scénographie (décor, lumières) : théâtre d’anatomie (exploration des âmes), jeux de miroirs, travail sur les lumières, une scène tournante au centre
- Recherche iconographique et l’accumulation des sources d’inspiration : documents issus de matériaux, d’une filmographie, d’impressions.
- Les aspects techniques d’une création : visite du plateau, les conditions de création d’un opéra, les métiers des techniciens, le vocabulaire technique…
Autour de la danse : 3 personnages d’animaux (sanglier, cerf et bêtes sauvages), incarnés par des circassiens-danseurs
- travail d’équilibre et de mime du mouvement des animaux
- ateliers sur le parcours d’Hercule, son caractère, ses exploits sportifs dans la réalisation de ses travaux.
Répétitions publiques, visite des coulisses, atelier chant parents-enfants, arts plastiques :
- Propositions de parcours aux classes à PAC, dans le cadre d’un PAG et de stages à l’attention des professeurs
- Atelier de chant parent-enfant : travail sur un air de l’Orfeo, avec une chanteuse intervenante de l’Arcal
- Parcours au musée du Louvre sur la représentation d’Hercule dans la peinture et la sculpture
- Bord de scène
- Conférence sur l’œuvre : musicologue, dramaturge
Fiche technique
Durée 2h45 + entracte
Opéra chanté en italien, surtitré en français
Public adultes & en famille , dès 10 ans.
Scolaires CM avec préparation, collèges, lycées.
Technique opéra avec fosse, 37 personnes en tournée.
Ressources
Dates
Plus de représentation à venir pour cette saison.
Historique des représentations
Mer. 27 sep. 2023
19:30
Théâtre-Sénart, Scène nationale / Lieusaint
Représentation
Inscrivez-vous
Sam. 30 sep. 2023
20:30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes
Représentation
Inscrivez-vous
Mer. 4 oct. 2023
19:30
Tandem, Scène nationale Arras Douai / Arras
Représentation
Inscrivez-vous
Ven. 8 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Sam. 9 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Mar. 12 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Mer. 13 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Ven. 15 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Sam. 16 déc. 2023
20:00
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet / Paris
Représentation
Inscrivez-vous
Sam. 2 mar. 2024
20:00
Les Bords de scènes • Espace Jean Lurçat / Juvisy-sur-Orge
Représentation
Inscrivez-vous
Sam. 18 jan.
20:30
Théâtre de Poissy / Poissy
Représentation
En coréalisation avec le Festival Baroque de Pontoise
Dim. 26 jan.
15:30
Atelier Lyrique de Tourcoing / Tourcoing
Représentation
Dim. 23 fév.
17:00
La Coursive, Scène nationale / La Rochelle
Représentation
Les autres spectacles
Don Giovanni
- Tout public
- Opéra
Don Giovanni (1787)
Musique W.-A. Mozart
Livret Lorenzo Da Ponte
Direction musicale Julien Chauvin • Le Concert de la Loge
Mise en scène Jean-Yves Ruf
Public pour tous • à partir de 11 ans
Durée 2h50 + entracte
Création Arcal novembre 2024

La Petite Sirène
- En famille
- Opéra de chambre
La Petite Sirène (2024)
Musique et texte Régis Campo (commande)
Mise en scène Bérénice Collet
Direction musicale Raoul Lay • Ensemble Télémaque
Public en famille • à partir de 6 ans
Durée 55 mn

Chimène, faire entendre sa voix
- Collégiens, lycéens
- Tout public
- Forme légère
- Hors les murs
Chimène, faire entendre sa voix (1783)
Musique Antonio Sacchini
texte Guillard d’après Le Cid de Corneille
Mise en scène Sandrine Anglade
Quatuor à cordes Concert de la Loge
Public pour tous à partir de 13 ans
Durée 1h