
Ce spectacle est disponible en tournée.
Votre contact : Catherine Lafont – +33 (0)6 67 33 26 59
La Petite Sirène
Opéra féérique (Nice, 2024)
Musique et livret de Régis Campo
Éditions Henry Lemoine
Mise en scène de Bérénice Collet
Dramaturgie Bérénice Collet
Direction musicale Raoul Lay
Ensemble Télémaque
Trouver sa voie…
… sans perdre sa voix
Comme enfermée dans un écrin aux mille détails, une boîte à musique, ou simplement une chambre d’adolescente, notre Sirène se tient dans un espace circonscrit sur scène et chargé de surprises, comme les éléments d’un rêve qui apparaîtraient soudain, les uns après les autres.
Pour se faire aimer, faut-il renoncer à ce que l’on est ? Comment le prince peut-il s’éprendre de la sirène si elle n’a plus sa voix propre ? C’est à cette réflexion que nous invite cette sirène d’aujourd’hui.
Téléchargez la Fiche DiffusionFichier PDF – 6 Mo
Téléchargez le dossier de presseFichier PDF – 6 Mo
Téléchargez la revue de presseFichier PDF – 6 Mo
Disponible en 2025-2026
direction Jane Lattron
Argument
Rêves aquatiques et désirs terrestres
La veille d’une grande décision, une adolescente s’endort. Traversée dans son rêve par la voix de la Petite Sirène qui, comme elle, s’apprête à commettre l’irréparable, elle voit sa chambre devenir le théâtre de tous les possibles : meubles et lumière se transforment, révélant un monde aquatique mystérieux et féérique, avant la rencontre éprouvante de la sorcière-araignée de mer, et la découverte du monde des humains.
Distribution
Direction musicale Raoul Lay • Ensemble Télémaque
Mise en scène Bérénice Collet
Scénographie & costumes Christophe Ouvrard
Lumières Alexandre Ursini
Créateur vidéo Christophe Waksmann
Avec les chanteur·euse·s
Clara Barber Serrano ou Apolline Raï-Westphal la petite sirène
Elsa Roux Chamoux ou Marion Pascal Vergez sa sœur
Etienne de Benazé ou Sebastian Monti le prince
Mathilde Ortscheidt ou Marion Lebègue la grand mère | la sorcière
Ensemble Télémaque direction Raoul Lay
Charlotte Campana flûte (en sol & piccolo)
Linda Amrani clarinette (+ clarinette basse)
Hubert Reynouard clavier électronique
Christian Bini percussions : cymbales, petites percussions
Yann Le Roux-Sèdes violon
Jean-Florent Gabriel violoncelle
Production
Production déléguée Arcal
Coproduction de la création Arsud-Région Sud • Opera Nice Côte-d’Azur • Opéra Grand Avignon • Opéra de Marseille • Opéra de Toulon • Ensemble Télémaque
Régis Campo par Raoul Lay
J’ai dirigé la musique de Régis Campo dès ses débuts, en 94, lorsque nous étions tous deux étudiants de George Boeuf au Conservatoire de Marseille.
Son univers sonore était déjà constitué, remarquable en regard de ce qui s’écrivait à l’époque, notamment sa capacité à façonner des alliages sur des jaillissements rythmiques de son cru.
Résolument libre et inventif, il savait déjà manier une large palette de couleurs et de timbres au service d’une musique riante, lumineuse.
Aujourd’hui, quoique totalement accessible, le langage de Campo se veut moderne, repoussant constamment les limites de la création.
C’est une alchimie rare que de parvenir à combiner ces éléments, et il y réussit avec une maîtrise exceptionnelle, laissant une empreinte durable dans le paysage musical contemporain.
Gageons qu’avec La Petite Sirène, Régis nous offrira une nouvelle perle de douceur et d’audace, pour toutes les oreilles.
Raoul Lay
Note d’intention de Bérénice Collet
Quelle bêtise irréparable peut commettre
un adolescent ?
L’Opéra, grâce à sa musique enveloppante et immersive, permet, comme les contes et le théâtre, de donner à penser aux spectateurs – ici, aux jeunes spectateurs et à leurs parents, dans un cadre propice. L’esprit détendu est réceptif à l’histoire qu’on lui raconte, et se laisse plus facilement atteindre par le message qu’on veut lui délivrer.
Derrière la féérie aquatique de Hans Christian Andersen se cache un propos qui concerne particulièrement les enfants et adolescents dans la construction de leur rapport à eux-mêmes et de leurs relations aux autres : La Petite Sirène est un conte cruel et initiatique. En se mutilant, en renonçant à ce qu’elle est dans l’espoir illusoire de se faire aimer, elle donne un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire.
La jeune créature de quinze ans décide de quitter un monde où elle est choyée mais dont la beauté et les richesses ne lui semblent plus suffisantes pour combler ses aspirations : les attraits mystérieux d’un autre monde, qui lui est étranger et avec lequel elle n’aurait jamais dû entrer en contact, charment son esprit jusqu’à l’obsession. Pour accéder à ce monde et espérer approcher le prince dont elle ne sait rien mais qui la fascine, elle doit consentir à des transformations physiques sans retour et des sacrifices sanglants.
La Petite Sirène, afin de suivre son désir, accepte l’inacceptable, sans comprendre que ce faisant, elle détruit tout espoir de parvenir à ses fins : pour obtenir les jambes dont elle rêve, elle doit renoncer pour toujours à sa voix, qu’elle donne en paiement à la sorcière. Elle se prive ainsi de tout moyen de communiquer avec le prince. Comment dans ces conditions pourrait-il s’éprendre d’elle et en faire sa femme ? Notons d’ailleurs ce message annexe délivré par le conte, que l’apparence physique n’est pas suffisante pour faire naître l’amour, quoi qu’en dise la sorcière.
Quoi qu’il en soit, la Petite Sirène a beau savoir que la mort l’attend si elle échoue et que le prince en épouse une autre, elle persévère jusqu’au bout dans sa folie.
Autour d’elle, plusieurs présences, bienveillantes ou non : celle de sa grand-mère, figure maternelle qu’elle refuse d’écouter ; sa sœur, spectatrice impuissante ; la sorcière, cassante, trompeuse et cruelle, mais à qui la jeune sirène confie néanmoins son sort ; le prince, être sans consistance : la Petite Sirène aurait pu tomber amoureuse de n’importe quel humain ; elle est plus amoureuse d’une idée, d’un exotisme, que d’une vraie personne.
La sensation pour le public est celle, terrible, d’assister à une catastrophe annoncée. Dans ce contexte d’une cruauté inouïe, afin que l’espoir demeure, notre opéra fera surgir l’histoire de La Petite Sirène dans le rêve d’une adolescente contemporaine, elle-même sur le point de commettre une bêtise irréparable. À son réveil, la visite qu’elle aura reçue en songe l’aidera à reprendre ses esprits et à donner un nouveau cours à sa vie.
La Petite sirène invite chacun à accepter de s’aimer tel qu’il est.
Se trahir, se mutiler, renoncer à ce que l’on est profondément ne permettra jamais de se faire aimer. Penser que l’on peut séduire quelqu’un en trahissant son identité profonde est une erreur dans laquelle il est facile de tomber à l’âge où l’on se cherche, où l’on apprend à se connaître et où l’on tisse des liens de plus en plus forts avec le monde qui nous entoure.
Comme enfermée dans un écrin aux mille détails, une boîte à musique, ou simplement une chambre d’adolescente, notre Sirène se tiendra dans un espace circonscrit sur scène et chargé de surprises, comme les éléments d’un rêve qui apparaitraient soudain les uns après les autres. Les musiciens encadreront cet espace d’images, baignés dans une lumière aquatique.
Nous chercherons l’émerveillement, en harmonie avec la musique féérique de Régis Campo, sans pour autant édulcorer la violence contenue dans le conte ô combien signifiant d’ Andersen.
Fiche technique
Durée 1h + entracte • opéra chanté en français.
Public en famille, 7 – 12 ans.
Scolaires du CM à la 5e.
Technique opéra sans fosse, 15 personnes en tournée.
La presse en parle
Forumopéra • Reflets dans l’eau
Dans le monde lyrique contemporain, des coopérations nombreuses sont parfois nécessaires pour donner naissance à une nouvelle œuvre. L’opéra de Nice, en partenariat avec les maisons d’Avignon, Toulon et Marseille ainsi que le Théâtre de l’Odéon (Marseille) et la compagnie ARCAL, présente actuellement le nouveau-né de Régis Campo : une adaptation de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen.
La Sirène s’adresse certes aux enfants, avec son « monde enchanteresse » et sa célébration de la beauté et du merveilleux – dans les mots du compositeur – mais Campo voulait aussi rester fidèle à la symbolique du conte, à ses « couleurs étranges ». Avec la metteuse en scène Bérénice Collet, il place le récit d’Andersen dans un cadre contemporain.
Campo enchaîne des situations répétitives et minimalistes aux sonorités étincelantes tels des reflets dans l’eau, des variations sur la nature du milieu océanique. Les structures évoluent imperceptiblement, englobant tout le spectre orchestral entre des ombres épaisses dans l’extrême grave et des gestes véloces dans l’aigu.
Le public sort enchanté et touché de cet opéra qui fera le tour des maisons partenaires avant d’arriver à Marseille en avril 2025, où il est déjà attendu avec impatience. Julian Lembke
[en savoir+]
Diapason • A Nice, « La Petite Sirène » de Régis Campo sort des eaux
Liquide, aquatique, tour à tour pailleté, chatoyant, lancinant et sombre, l’accompagnement instrumental est joué directement sur scène.
La partition de Régis Campo est traversée d’influences revendiquées : les glissandos omniprésents figurant le mouvement des vagues, qui citent l’ouverture du Midsummer Night’s Dream, de Britten ; les harmoniques du Vaisseau fantôme (que le compositeur écoutait enfant) dans le récit de la scène du naufrage ; les cordes étirées et tranchantes qui dramatisent le poignant lamento final de la sirène et évoquent Arvo Pärt.
Les transitions scéniques se font avec un naturel et une fluidité qui ferait presque oublier qu’elles résultent d’une chorégraphie millimétrée, ingénieuse et précise.
Mention spéciale aux costumes… en particulier les somptueux plissés des robes des sirènes, quelque part entre Issey Miyake, Iris van Herpen et… la Fée des Lilas.
On retiendra tout particulièrement le magnifique duo des deux mezzos : la sœur et la grand-mère mêlant leurs voix à la tierce dans un chant lancinant, émouvant, presque voluptueux. François Stagnaro
[en savoir +]
Dates
Sam. 8 nov.
14:30
Opéra de Toulon Provence Méditerranée / Toulon
Représentation
Sam. 8 nov.
19:30
Opéra de Toulon Provence Méditerranée / Toulon
Représentation
Mar. 25 nov.
20:00
Forum Jacques Prévert – Carros / carros
Représentation
Mar. 25 nov.
14:30 (scolaire)
Forum Jacques Prévert – Carros / carros
Représentation
Ven. 5 déc.
Palais des beaux-arts de Charleroi / Charleroi
Représentation
Historique des représentations
Sam. 9 mar. 2024
15:00
17:00
Opéra Nice Côte d’Azur • Conservatoire à rayonnement régional / Nice
Représentation
Mar. 12 mar. 2024
10:30 (représentation scolaire)
14:30 (représentation scolaire)
Opéra Nice Côte d’Azur • Conservatoire à rayonnement régional / Nice
Représentation
Sam. 16 nov. 2024
18:00
Cité des Arts • CRR Grand Besançon Métropole / Besançon
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté (OVFC)
Représentation à l’Auditorium
dans le cadre de RENDEZ-VOUS CONTE #1 de l’OVFC
Dim. 17 nov. 2024
16:00
MA scène nationale / Montbéliard
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté (OVFC)
Représentation au théâtre de Montbéliard
dans le cadre des OUVERTURES MUSICALES ! de MA scène nationale
& de RENDEZ-VOUS CONTE #1 de l’OVFC
Ven. 10 jan.
14:00 (scolaire)
16:00 (scolaire)
Théâtre des Salins • Scène nationale / Martigues
Représentation
dir. musicale Raoul Lay
Ensemble Télémaque
Sam. 11 jan.
19:00 (tout public)
Théâtre des Salins • Scène nationale / Martigues
Représentation
dir. musicale Raoul Lay
Ensemble Télémaque
Jeu. 6 fév.
14:30 (scolaire)
Opéra Grand Avignon • L’Autre Scène / Avignon
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre national Avignon-Provence
Ven. 7 fév.
20:00 (tout public)
Opéra Grand Avignon • L’Autre Scène / Avignon
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre national Avignon-Provence
Jeu. 3 avr.
10:00 (scolaire)
14:30 (scolaire)
Opéra de Marseille / Marseille
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre de l’Opéra de Marseille
Représentation au Théâtre de l’Odéon
Sam. 5 avr.
14:30 (tout public)
Opéra de Marseille / Marseille
Représentation
dir. musicale Jane Latron
Orchestre de l’Opéra de Marseille
Représentation au Théâtre de l’Odéon
Jeu. 24 avr.
20:00
Les Théâtres / Aix-en-provence
Représentation
Ven. 25 avr.
15:00
Les Théâtres / Aix-en-provence
Représentation
Ven. 23 mai
20:00 (tout public)
Opéra de Massy / Massy
Représentation
dir. musicale Raoul Lay
Ensemble Télémaque
Les autres spectacles
Don Giovanni
- Tout public
- Opéra
Don Giovanni (1787)
Musique W.-A. Mozart
Livret Lorenzo Da Ponte
Direction musicale Julien Chauvin • Le Concert de la Loge
Mise en scène Jean-Yves Ruf
Public pour tous • à partir de 11 ans
Durée 2h50 + entracte
Création Arcal novembre 2024

Orfeo
- Tout public
- Opéra
Orfeo (1672)
Musique Antonio Sartorio
Livret Aurelio Aureli
Mise en scène Benjamin Lazar
Direction musicale Philippe Jaroussky | Brice Sailly • Ensemble Artaserse
Public pour tous • en famille dès 11 ans
Durée 2h45 + entracte
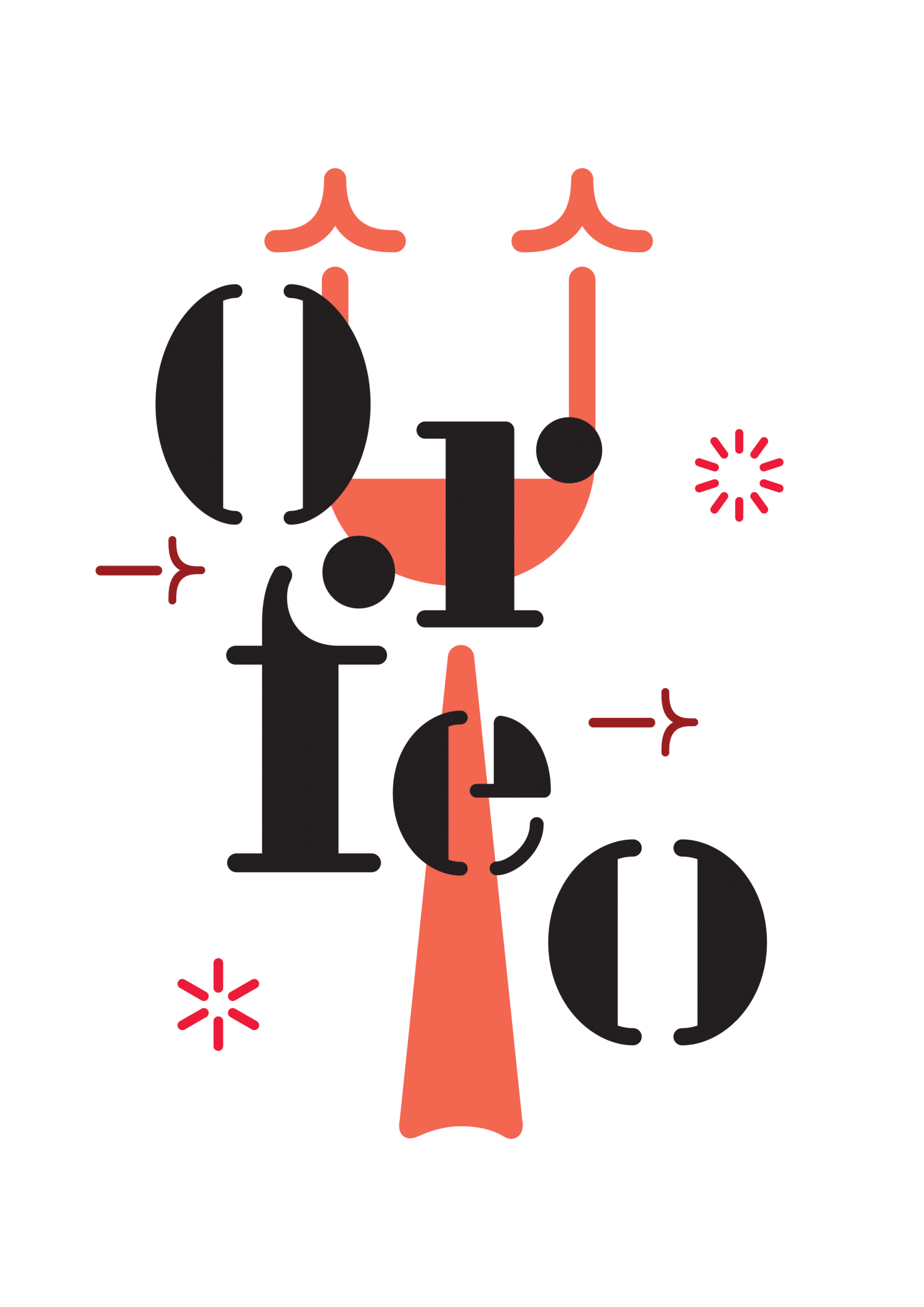
Chimène, faire entendre sa voix
- Collégiens, lycéens
- Tout public
- Forme légère
- Hors les murs
Chimène, faire entendre sa voix (1783)
Musique Antonio Sacchini
texte Guillard d’après Le Cid de Corneille
Mise en scène Sandrine Anglade
Quatuor à cordes Concert de la Loge
Public pour tous à partir de 13 ans
Durée 1h
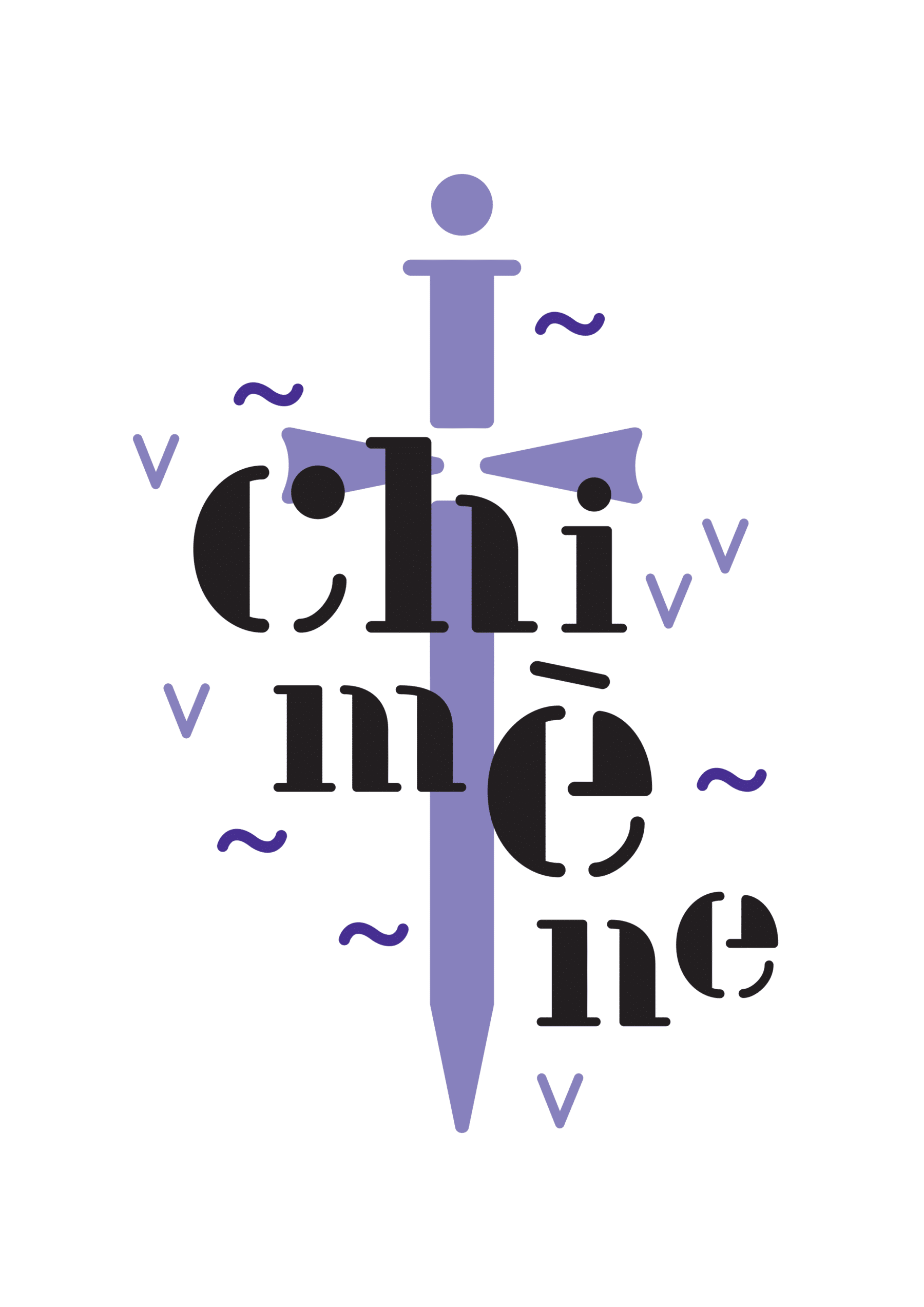
Zaïna
- Jeune Public – 6-10 ans
- Forme légère
- Hors les murs
Zaïna (2003)
Musique Jonathan Pontier
Texte Lucette Salibur
Mise en scène Christian Gangneron
Public pour tous • en famille dès 6 ans
Durée 45 mn






